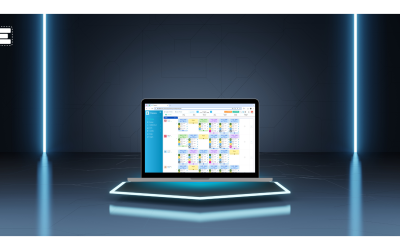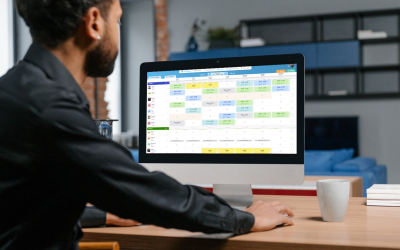Vous avez dit congés payés imposés ? Du côté du salarié, on imagine déjà une valise qui claque toute seule. Côté employeur, on pense plutôt organisation, période de fermeture et continuité d’activité. Bonne nouvelle : le Code du travail encadre précisément qui décide quoi, quand, et comment — de la période de prise des congés à l’ordre des départs, en passant par le délai de prévenance. Autrement dit, il ne s’agit ni d’un droit “magique” du manager, ni d’un veto du salarié : ce sont des règles, des dates et des conditions… à respecter.
Dans cet article, on fait le point sur les règles des congés imposés par l’employeur : conditions légales, durée maximale, modalités de prise, exceptions (fermeture de l’entreprise, baisse d’activité, circonstances exceptionnelles), et droits du salarié (refus, information, indemnité, litiges). Vous y trouverez aussi des exemples concrets pour fixer l’ordre de départ, prévenir à temps, et éviter les effets « dernière minute » qui fâchent tout le monde.
Objectif : aider chaque entreprise à organiser la prise des congés sans heurts, et chaque salarié à comprendre ses droits, afin que les congés restent… des congés.
L’employeur peut-il imposer des congés payés ? Règles durée conditions
Imposer des congés payés : ce que dit la loi
Oui, un employeur peut imposer des congés payés à ses salariés, mais à certaines conditions bien précises. Ce pouvoir découle de son droit d’organisation de l’entreprise, reconnu par le Code du travail. Il permet d’assurer la continuité de l’activité, d’anticiper les fermetures temporaires et de répartir équitablement les périodes de repos entre collaborateurs.
Cependant, ce droit n’est pas absolu : l’employeur doit respecter le droit à un congé garanti à chaque salarié, ainsi que les règles légales de prévenance et de durée. Imposer des congés payés ne signifie pas priver le salarié de son choix, mais organiser leur prise dans l’intérêt collectif de l’entreprise.
Les conditions pour imposer des congés payés
Pour être légitime, la décision de l’employeur doit :
1. S’appuyer sur une période de prise de congés préalablement fixée ;
2. Respecter un délai de prévenance d’au moins un mois ;
3. Être motivée par une raison objective (baisse d’activité, fermeture annuelle, réorganisation du service) ;
4. Être communiquée de manière claire et écrite à l’ensemble du personnel.
En cas de non-respect de ces conditions, le salarié peut contester la décision devant le conseil de prud’hommes.
Exemple concret : la fermeture annuelle
Prenons un exemple classique : une entreprise de production ferme trois semaines en août. L’employeur peut imposer à tous les salariés de poser leurs congés payés sur cette période, à condition d’en avoir informé le personnel au moins un mois à l’avance et de respecter le droit à un congé complet.
Cette pratique est fréquente dans l’industrie, l’artisanat ou le commerce de détail. Elle permet d’éviter le chômage partiel tout en maintenant le repos des salariés.
Le rôle de la jurisprudence
La jurisprudence française rappelle régulièrement que le droit à un congé payé est un droit fondamental, mais qu’il peut être organisé par l’employeur dans le cadre légal. Par exemple, la Cour de cassation, 13 juin 2012 a confirmé que les congés imposés sont valables dès lors que les règles de consultation et de prévenance ont été respectées.
Ainsi, l’employeur peut imposer des congés payés pour des raisons économiques, organisationnelles ou de sécurité, à condition de le faire dans le respect des textes en vigueur.
Quelles sont les règles des congés imposés ?
Les règles, durée et conditions légales
Les règles des congés imposés par l’employeur sont fixées par les articles L3141-12 à L3141-23 du Code du travail. Ces dispositions définissent les conditions et la durée légale de prise des congés payés :
-
Chaque salarié a droit à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) de congé par an ;
-
L’employeur fixe la période de prise après consultation du CSE ;
-
Les dates de départ doivent être communiquées au moins un mois à l’avance ;
-
Le fractionnement est possible sous conditions, sauf accord collectif contraire.
Les conditions à respecter pour imposer des congés payés
Pour imposer des congés payés, l’employeur doit :
-
Prendre en compte la situation familiale des salariés (parents isolés, couples travaillant dans la même entreprise) ;
-
Veiller à une équité de traitement entre collaborateurs ;
-
Consulter le CSE avant toute fermeture de site ;
-
Mentionner clairement les dates de fermeture dans une note interne ou un affichage visible.
Ne pas respecter ces obligations peut entraîner une sanction prud’homale ou une indemnisation du salarié pour préjudice subi.
Cas pratiques : quand les congés imposés deviennent nécessaires
1. Fermeture pour maintenance ou inventaire : un entrepôt ferme dix jours pour travaux. Les salariés sont tenus de poser leurs congés sur cette période.
2. Baisse d’activité saisonnière : dans un restaurant, l’employeur impose des congés en janvier, période creuse.
3. Réorganisation interne : une fusion d’équipes nécessite la fermeture du service pendant deux semaines.
Dans ces cas, les congés imposés par l’employeur sont légaux dès lors qu’ils respectent les conditions de durée légale et le délai de prévenance.
Combien de jours de congés peuvent être imposés ?
Le nombre de jours maximum
Pendant la période principale (1ᵉʳ mai–31 octobre), le congé principal comprend au moins 12 jours ouvrables consécutifs et maximum 24 jours ouvrables consécutifs. Cette durée maximale vise à garantir à la fois la bonne marche de l’entreprise et le droit au repos du salarié.
Au-delà de ces quatre semaines, les congés restants doivent être pris ultérieurement, selon un accord entre l’employeur et le salarié.
Le fractionnement des congés
Lorsque la période principale n’épuise pas les droits du salarié, il est possible de fractionner les congés. Par exemple, un salarié peut prendre trois semaines en été, puis une semaine en hiver. Ce fractionnement peut ouvrir droit à des jours supplémentaires – hors période légale, à 1 jour (3 à 5 jours pris) ou 2 jours (6 jours et plus) – selon les conventions collectives.
Exemple : une entreprise fermée pour congés collectifs
Une société de logistique ferme son entrepôt pendant 24 jours ouvrables en août. Tous les salariés doivent poser leurs congés pendant cette période. Les six jours restants peuvent être pris plus tard, en accord avec le responsable. Cette organisation permet d’optimiser la planification du travail tout en respectant le droit au congé.
En résumé, l’employeur peut imposer des congés payés dans la limite de 24 jours consécutifs pour la période principale. Au-delà de 24 jours ouvrables consécutifs, les jours de fermeture excédentaires ne peuvent pas être imputés sur les congés légaux : ils donnent lieu, selon les cas, à une indemnisation (ex. absence de congés acquis suffisants) ou à un autre dispositif prévu par les textes ou accords applicables.
Quels sont les délais de prévenance pour les congés ?
Le délai de prévenance légal : un mois minimum
Le délai de prévenance est un élément central dans la gestion des congés payés imposés. Selon le Code du travail, l’employeur doit prévenir un mois à l’avance l’ordre et les dates de départ et porter à la connaissance des salariés la période de prise au moins 2 mois avant son ouverture. Respecter un délai de prévenance suffisant garantit à chacun le temps de s’organiser personnellement et professionnellement.
En résumé :
-
2 mois avant → on communique la période générale où les congés seront pris.
-
1 mois avant → on communique les dates précises de chaque personne.
Ne pas respecter un délai d’un mois peut être considéré comme une faute de l’employeur, sauf si un accord collectif prévoit des modalités différentes ou si une situation exceptionnelle le justifie.
Les exceptions prévues par la loi
Certaines circonstances exceptionnelles permettent de réduire le délai de prévenance :
-
Travaux urgents nécessaires à la sécurité de l’établissement ;
-
Baisse d’activité brutale ;
-
Crise sanitaire ou fermeture administrative.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date initialement prévue, sous réserve d’en justifier le motif et d’informer le CSE. Hors de ces hypothèses, le préavis d’un mois demeure la règle.
Exemple concret : fermeture pour travaux
Une pharmacie décide de fermer pendant dix jours pour rénovation suite à un dégât des eaux. L’employeur informe les salariés deux semaines avant. Bien que le délai de prévenance ne soit pas d’un mois, la situation exceptionnelle justifie une réduction.
Sanctions en cas de non-respect du délai
Si l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance, le salarié peut :
-
Refuser les congés imposés ;
-
Réclamer une indemnisation pour préjudice devant le conseil de prud’hommes ;
-
S’appuyer sur la jurisprudence (Cass. soc., 13 juin 2012) qui protège le droit au repos et le respect de la prévenance.
Peut-on refuser des congés imposés ?
Le principe : le refus est encadré
Le salarié peut refuser un congé imposé uniquement si l’employeur ne respecte pas les obligations légales. Le refus des congés est justifié si :
-
Le délai de prévenance n’a pas été respecté ;
-
Les dates imposées sortent de la période légale ;
-
La décision ne repose sur aucun motif objectif.
En revanche, si toutes les règles sont respectées, refuser des congés imposés sans motif valable peut être considéré comme une faute disciplinaire.
Les conditions de refus valables
Un salarié peut refuser uniquement s’il démontre :
-
Une atteinte à ses droits fondamentaux (ex : congé parental prévu) ;
-
Un manque d’information ou une absence de consultation du CSE ;
-
Une discrimination dans le choix des périodes de congés.
Dans ces cas, le salarié doit d’abord chercher une solution amiable avant d’entamer une procédure prud’homale.
Exemple pratique : refus légitime
Un salarié est informé dix jours avant une fermeture exceptionnelle et ne peut pas s’organiser pour la garde de ses enfants. Le refus des congés imposés est alors considéré comme légitime, car le délai de prévenance légal d’un mois n’a pas été respecté.
Quelles sont les exceptions pour les congés imposés ?
Les exceptions prévues par le Code du travail
Il existe plusieurs exceptions aux congés payés imposés, permettant à l’employeur d’adapter la période de prise en fonction de circonstances particulières. Ces exceptions congés imposés concernent notamment :
-
Les fermetures annuelles décidées pour des raisons économiques ou techniques ;
-
Les situations exceptionnelles comme une baisse d’activité significative ;
-
Les travaux ou rénovations nécessitant la fermeture des locaux ;
-
Les périodes de crise (pandémie, sinistre, incendie).
Les congés payés en cas de baisse d’activité
Lorsqu’une entreprise subit une baisse d’activité, elle peut imposer des congés payés à ses salariés pour éviter de recourir au chômage partiel. Cette pratique reste encadrée par un accord collectif ou une autorisation exceptionnelle.
Exemple : un hôtel impose une semaine de congés en février, période creuse. L’objectif : réduire les coûts tout en respectant les droits des salariés.
Situations exceptionnelles et cas particuliers
En cas de force majeure, l’employeur peut décider unilatéralement de fermer l’entreprise et d’imposer des congés payés. Toutefois, cette mesure doit rester proportionnée et temporaire.
Certaines conventions collectives prévoient des dispositions spécifiques pour :
-
Les salariés en CDD ;
-
Les travailleurs à temps partiel ;
-
Les cas de maladie ou d’accident pendant les congés.
Dans ces situations, le salarié conserve ses droits à congé ou perçoit une indemnité compensatrice s’il ne peut pas les utiliser.
Comment se déroule la prise des congés ?
La période de prise des congés payés
La période de prise des congés est fixée par l’employeur après consultation du CSE, souvent entre le 1er mai et le 31 octobre. Durant cette période, il peut imposer des congés payés à condition d’en informer les salariés au moins un mois à l’avance.
Le but : garantir une organisation harmonieuse entre les besoins de l’entreprise et le droit au repos des salariés.
Les étapes de la prise de congés imposés
1. Définir la période de référence pour l’acquisition des congés payés acquis ;
2. Fixer les dates de congés imposés selon les nécessités du service ;
3. Informer individuellement chaque salarié ;
4. Mettre à jour les plannings et les outils de gestion ;
5. Vérifier que le droit à un congé complet est respecté.
Exemple concret : organisation des congés dans un commerce
Une boutique décide d’imposer deux semaines de fermeture en juillet. Les salariés sont prévenus en mai, les plannings mis à jour et les congés enregistrés. La prise des congés respecte la période de prise légale et les règles de prévenance, rendant la mesure parfaitement conforme.
Comment calculer l’indemnité de congés payés imposés ?
Les deux méthodes de calcul prévues par la loi
Lorsqu’un salarié prend des congés payés imposés, il perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la période non travaillée. Le Code du travail prévoit deux méthodes de calcul :
– Le maintien de salaire : le salarié conserve le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé ;
– La règle du dixième : l’indemnité équivaut à un dixième de la rémunération brute totale perçue pendant la période de référence (article L3141-24).
L’employeur doit appliquer la méthode la plus favorable pour le salarié.
Exemple concret de calcul
Un salarié ayant perçu 30 000 € sur la période de référence bénéficie d’une indemnité de 3 000 € (1/10e), si cette méthode est plus avantageuse que le maintien de salaire. Le montant est versé sur la paie du mois du congé et figure clairement sur le bulletin de salaire.
Cas particuliers
-
CDD : si le contrat prend fin avant la prise effective des congés, le salarié reçoit une indemnité compensatrice de congés payés ;
-
Maladie ou accident : depuis avril 2024, un arrêt non professionnel ouvre droit à 2 jours de congés/mois, dans la limite de 24 jours par période de référence ; et depuis l’arrêt du 10 septembre 2025, la maladie survenant pendant les congés permet le report des jours coïncidant avec l’arrêt.
-
Temps partiel : le calcul se fait au prorata du temps de travail effectué.
Que faire si l’employeur modifie les congés à la dernière minute ?
Modification des congés : les limites légales
Modifier les dates de congés payés imposés à la dernière minute est strictement encadré. Sauf accord du salarié, une telle décision peut être considérée comme une faute de l’employeur. Cependant, certaines circonstances exceptionnelles peuvent justifier cette modification :
-
Risques pour la sécurité du personnel ou des locaux ;
-
Travaux urgents ;
-
Baisse d’activité imprévue mettant en péril l’entreprise.
Dans ces cas, l’employeur doit informer immédiatement les salariés concernés et proposer des solutions alternatives.
Exemple : report de congés pour urgence technique
Une usine subit une panne majeure nécessitant la présence des techniciens. L’employeur peut exceptionnellement modifier la période de congés pour éviter une perte d’exploitation. Mais il doit offrir des jours de repos compensateurs ou indemniser le préjudice.
Les recours du salarié
Si la modification n’est pas justifiée, le salarié peut :
-
Refuser la modification ;
-
Saisir le CSE ;
-
Déposer une plainte devant le conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts.
Combien de semaines l’employeur peut-il imposer ?
La durée maximale légale
L’employeur peut imposer jusqu’à quatre semaines consécutives de congés payés pendant la période principale (1er mai – 31 octobre). Cette durée correspond à 24 jours ouvrables.
Les six jours restants peuvent être pris ultérieurement, selon un accord entre l’employeur et le salarié ou selon la convention collective applicable.
Les règles de fractionnement
Si le salarié ne prend pas la totalité de ses congés pendant la période principale, il peut bénéficier de jours supplémentaires de fractionnement. Ces jours, souvent fixés à un ou deux, visent à compenser la prise des congés en dehors de la période légale.
Exemple pratique
Une entreprise ferme quatre semaines en été : tous les salariés sont concernés. En revanche, si un collaborateur choisit de reporter une semaine à l’automne avec l’accord de la direction, il peut obtenir un jour de congé supplémentaire.
Quels recours pour le salarié en cas de litige ?
Étape 1 : dialogue interne
Avant toute démarche judiciaire, le salarié doit privilégier le dialogue interne : en parler à son supérieur, au service RH ou au CSE.
Étape 2 : inspection du travail
Si le désaccord persiste, il peut contacter l’inspection du travail, qui vérifie le respect des règles légales et des accords collectifs.
Étape 3 : saisine du conseil de prud’hommes
En dernier recours, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour contester des congés payés imposés abusifs. Les juges examinent alors :
-
Le respect du délai de prévenance ;
-
La motivation réelle de la décision ;
-
L’éventuelle discrimination entre salariés.
Si la faute est avérée, le salarié peut obtenir une indemnisation financière pour le préjudice subi.
Les bénéfices d’une bonne gestion des congés payés imposés
Pour l’entreprise : planification et sérénité
Une gestion rigoureuse des congés payés imposés permet à l’entreprise d’anticiper les périodes creuses, d’éviter les surcharges et de garantir la continuité d’activité. Elle réduit aussi le risque de litiges sociaux.
Pour les salariés : clarté et équilibre
Un cadre clair de prise de congés favorise la confiance et permet aux salariés d’organiser leur vie personnelle sereinement. Ils bénéficient d’un droit à un congé respecté et planifié à l’avance.
Pour les RH : conformité et transparence
Les responsables RH disposent de repères légaux solides pour imposer des congés payés sans risque. Le respect du délai de prévenance, des règles de durée et des accords collectifs garantit une gestion fluide et conforme.
En résumé, une politique de congés payés imposés bien encadrée protège à la fois l’entreprise et ses salariés, tout en assurant une meilleure organisation collective.