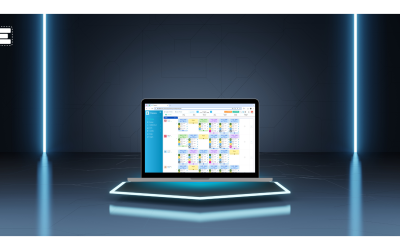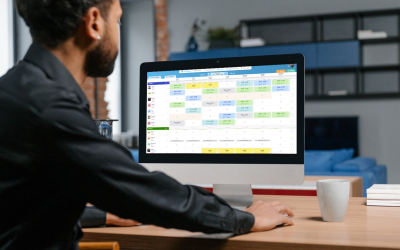L’« heure sup’ », cette expression que tout salarié a déjà entendue à la machine à café, suscite autant de questions que de débats. Est-ce une aubaine pour le salarié qui veut arrondir son salaire ? Une obligation imposée par l’employeur ? Une gymnastique juridique entre durée légale, contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos ? En réalité, les heures supplémentaires sont au cœur du droit du travail français et concernent la quasi-totalité des entreprises du secteur privé.
Concrètement, une heure supplémentaire correspond à toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures (article L3121-28 du Code du travail). Ces heures ouvrent droit à une rémunération majorée ou à un repos compensateur, selon les cas. Mais leur cadre d’application est strict : limites, conditions, taux de majoration, exonérations fiscales… autant de notions que tout salarié et tout employeur doivent maîtriser.
Dans cet article, nous allons détailler tout ce qu’il faut savoir sur les heures supplémentaires : leur définition, leur calcul, leurs droits et obligations, les compensations possibles, et les règles applicables en 2025.
Qu’est-ce qu’une heure supplémentaire ?
Une heure supplémentaire est une heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. La définition est posée par le Code du travail (article L3121-28). Concrètement :
- Si un salarié travaille 37 heures dans la semaine, il aura 2 heures supplémentaires.
- Même si l’entreprise organise un horaire collectif supérieur (ex. 39 h), le décompte des heures supplémentaires reste hebdomadaire par rapport à 35 h (semaine civile). Seuls des régimes d’« équivalence » prévus par texte ou accord de branche modifient la référence ; les heures au-delà de l’équivalence redeviennent des heures supplémentaires.
Bon à savoir : les heures supplémentaires ne concernent pas uniquement les contrats à temps plein. Les salariés à temps partiel peuvent eux aussi effectuer des heures, appelées heures complémentaires (article L3123-8 du Code du travail).
Comment calculer les heures supplémentaires ?
Le calcul des heures supplémentaires repose sur plusieurs éléments :
- Le décompte hebdomadaire : on additionne toutes les heures de travail effectif sur la semaine.
- La durée légale : toute heure au-delà de 35 heures devient une heure supplémentaire.
- La majoration : elle est appliquée en fonction du seuil dépassé.
En pratique, le taux de majoration est de :
- +25 % pour les 8 premières heures (de la 36e à la 43e incluse),
- +50 % pour les suivantes (au-delà de la 44e).
- Un accord peut fixer d’autres taux, sans descendre sous 10 % par taux.
À défaut d’accord, la majoration est de 25 % pour les 8 premières heures (36e à 43e) puis 50 % au-delà. Un accord peut fixer d’autres taux, sans descendre sous 10 %.
Exemple : un salarié payé au SMIC (11,88 € brut/heure en 2025) qui effectue 39 heures percevra :
- 35 heures au taux normal,
- 4 heures supplémentaires majorées de 25% = 4 × 14,85 € brut = 59,40 € brut.
Les heures supplémentaires doivent figurer distinctement sur le bulletin de paie (nombre et taux). L’employeur tient les documents nécessaires au décompte des heures (L3171-2/L3171-3) ; lorsque le temps est enregistré automatiquement, le système doit être fiable et infalsifiable (L3171-4, al. fin). En cas de litige, la preuve est partagée : le salarié présente des éléments précis et l’employeur répond (L3171-4), le juge tranchant au vu de l’ensemble.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 (n° 23-14.455), un salarié dont le temps de travail est décompté à la semaine peut prétendre aux majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine, y compris lorsqu’il a pris des jours de congés payés.
Cette décision ne modifie pas directement l’article L.3121-28 du Code du travail, mais en précise l’interprétation afin de la rendre conforme au droit de l’Union européenne.
La Cour rappelle que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social européen, et qu’un désavantage financier lié à la prise de congés pourrait dissuader un salarié d’exercer ce droit, ce qui serait contraire à son objectif protecteur.
Qui est concerné ?
Cette jurisprudence s’applique uniquement aux salariés dont le temps de travail est décompté à la semaine.
Elle ne concerne pas :
– les salariés à temps partiel ;
– les salariés au forfait-jours ;
– les salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (mensualisation, annualisation, modulation).
Exemple concret d’application
Un salarié travaille habituellement 7 heures par jour, du lundi au vendredi (35 h/semaine).
Une semaine donnée, il prend son lundi en congé payé et travaille 9 heures du mardi au vendredi.
Calcul selon l’arrêt du 10 septembre 2025 :
– Lundi : 7 h de congé payé (assimilées pour le calcul du seuil hebdomadaire)
– Mardi à vendredi : 36 h travaillées (4 jours × 9 h)
– Total pris en compte : 43 h
Le salarié peut donc prétendre aux majorations d’heures supplémentaires pour les 8 heures au-delà de 35 h (de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure), majorées à 25 %.
Avant cet arrêt : seules les heures de travail « effectif » étaient retenues. Le salarié n’aurait bénéficié que d’une seule heure majorée (la 36ᵉ) et de 7 heures «normales» au taux sans majoration.
Désormais, l’assimilation du jour de congé permet de déclencher davantage d’heures majorables, sans qu’il ait réellement travaillé ces heures.
Conséquences pour les employeurs
Les entreprises doivent :
– adapter leurs logiciels de paie et de gestion du temps pour intégrer cette assimilation ;
– former les équipes RH et managers à cette évolution jurisprudentielle ;
– anticiper l’impact financier, car davantage d’heures seront désormais majorables.
Les salariés peuvent également réclamer un rappel de salaire sur les trois dernières années, conformément à l’article L.3245-1 du Code du travail.
Quels sont les droits des salariés ?
Un salarié qui effectue des heures supplémentaires bénéficie de plusieurs droits :
- Une rémunération majorée (25 % ou 50 % selon le nombre d’heures).
- Un repos compensateur de remplacement (dans certaines entreprises, les heures ne sont pas payées mais donnent droit à du repos supplémentaire).
- Une contrepartie obligatoire en repos (COR) lorsque le contingent annuel est dépassé : l’article L3121-30 du Code du travail dispose que les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
- Une convention collective peut prévoir des conditions encore plus favorables que le Code du travail (par exemple, une majoration de 50 % dès la 36e heure dans certaines branches).
- Le salarié a le droit de contester en cas de non-paiement et d’exiger ses contreparties devant les prud’hommes.
Important : En principe, le salarié ne peut pas refuser des heures supplémentaires demandées par l’employeur. Il ne peut pas être sanctionné s’il les refuse exceptionnellement faute de prévenance suffisante.
Quelles sont les obligations de l’employeur ?
Du côté de l’employeur, plusieurs obligations existent :
- Tenir un décompte précis des heures effectuées.
- Payer ou compenser les heures supplémentaires effectuées.
- Respecter les limites légales : la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines).
- Le contingent annuel est fixé par accord (à défaut : 220 h/an). Au-delà, les heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos ; les modalités d’utilisation et de dépassement relèvent de l’accord et s’inscrivent dans le cadre des textes (L3121-27 s. et D3121-24, etc.). À défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent annuel et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à consultation du CSE (Comité Social et Économique).
- Ne pas sanctionner un salarié qui refuse des heures sup’ au-delà des limites légales (Cass. soc., 4 juill. 2012, n°11-14.133).
Le non-paiement expose l’employeur à des rappels de salaire et dommages-intérêts, le juge statuant au vu des éléments fournis par les deux parties (partage de la preuve, L3171-4), conformément à la jurisprudence sociale récente.
Quels types d’heures supplémentaires existent ?
On distingue plusieurs formes d’heures supplémentaires :
- Les heures supplémentaires classiques : effectuées ponctuellement au-delà de 35 h.
- Les heures supplémentaires structurelles (intégrées à l’horaire ou au forfait en heures) bénéficient des mêmes règles de majoration et des mêmes dispositifs d’allègement : réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse (jusqu’à 11,31 %) et, selon l’effectif, déduction forfaitaire patronale.
- Les heures complémentaires : spécifiques aux contrats à temps partiel.
- Les heures de dépassement exceptionnelles : demandées dans le cadre d’un pic d’activité ou d’une urgence.
Quelles sont les exonérations fiscales et sociales ?
Depuis la loi TEPA (2007) réactivée en 2019 et toujours en vigueur en 2025, les heures supplémentaires bénéficient d’un régime fiscal avantageux :
- Exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 7 500 €.
- Exonération partielle de cotisations sociales salariales.
Concrètement :
- Le montant exonéré vient en déduction directe du revenu imposable.
- Les cotisations sociales (hors CSG et CRDS) sont allégées, augmentant le net perçu.
- Le plafond de 7 500 € concerne l’ensemble des heures supplémentaires de l’année.
Ce dispositif bénéficie aussi bien aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel effectuant des heures complémentaires.
Les bénéfices des heures supplémentaires
Pour le salarié :
- Un gain de salaire immédiat (rémunération majorée).
- Une possibilité de repos compensateur.
- Un avantage fiscal intéressant.
Pour l’entreprise :
- Une souplesse en cas de hausse ponctuelle de l’activité.
- Une optimisation des effectifs sans recrutement supplémentaire.
- Un levier de motivation pour le personnel, si les règles sont appliquées correctement.
Attention toutefois : un recours abusif peut générer de la fatigue, des absences et une hausse de l’absentéisme. l’INRS souligne qu’allonger les amplitudes (postes longs/horaires atypiques) accroît le risque d’accident et d’erreurs, d’où l’importance de limiter les dépassements et d’organiser les repos.
Les limites et le contingent annuel
Le Code du travail fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires. En 2025, ce contingent est généralement fixé à 220 heures par an et par salarié, sauf accord ou convention spécifique.
Au-delà de ce seuil :
- L’employeur doit consulter le CSE.
- Le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.
De plus, il existe des limites à ne pas dépasser :
- Durée quotidienne maximale : 10 heures.
- Durée hebdomadaire maximale : 48 heures (avec tolérance exceptionnelle à 60 heures, sur autorisation de l’autorité administrative après avis du CSE, en circonstances exceptionnelles)
Qui décide des heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont décidées par l’employeur, qui peut les imposer dans le cadre de son pouvoir de direction. Toutefois :
- Elles doivent respecter les plafonds légaux et conventionnels.
- Le salarié protégé (délégué syndical, représentant du personnel) bénéficie d’une protection particulière.
- Le refus d’un salarié peut être justifié si la demande dépasse les limites légales ou si elle intervient dans un délai trop court.
Conséquences en cas de non-paiement
Le non-paiement des heures supplémentaires constitue un manquement de l’employeur pouvant, selon les circonstances, être jugé suffisamment grave pour justifier une prise d’acte ou une résiliation judiciaire. Le salarié peut :
- Saisir le Conseil de prud’hommes.
- Fournir des preuves (emails, planning, décompte personnel, relevés de badgeage).
- Obtenir des rappels de salaire et des dommages-intérêts.
(Source : Cass. soc., 3 mars 2021 – rappel de la règle L3171-4 sur la preuve des heures ; voir aussi Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-15.842. Cass. soc., 27 nov. 2014, n° 13-18.716 (prise d’acte/gravité) ; principe de la prise d’acte réservée aux manquements suffisamment graves.)
Gérer le décompte précis des heures supplémentaires peut rapidement devenir un casse-tête, surtout quand il faut jongler entre accords collectifs, contingent annuel et bulletins de paie. Pour éviter les erreurs et gagner du temps, de nombreuses entreprises utilisent un logiciel de gestion du temps et des activités.
Avec Planeezy, vous planifiez, suivez et validez vos heures en toute sérénité.